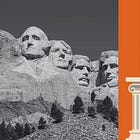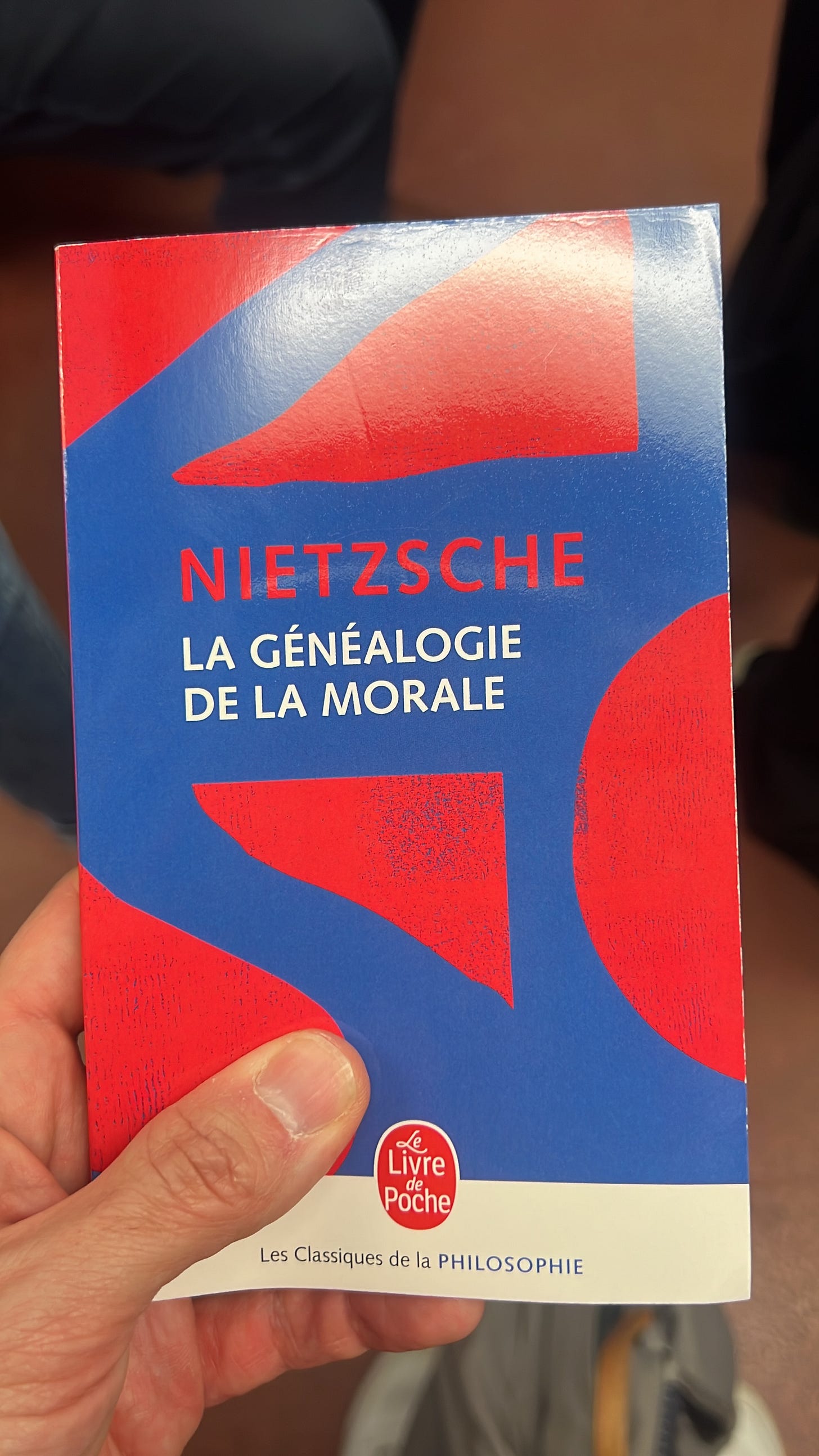Les racines allemandes de Trump sont peut-être plus profondes qu’on ne le pense.
Car avant les tours et les tweets, il y eut Frederick. Le grand-père originaire de Bavière. En 1885, à seize ans, il traverse l’Atlantique. Peut-être qu’entre deux chemises, il glissa dans son bagage quelque chose d’un autre Friedrich.
Et si quelque chose de cette voix-là avait survécu ?
En feuilletant La Généalogie de la morale, je n’ai pas pu m’empêcher d’y songer. Entre la pensée de Nietzsche et les outrances de Trump, je retrouve un parfum commun : celui d’une morale renversée.
Reprenons les choses à la source et creusons notre Nietzsche ensemble. Que nous dit-il dans Généalogie de la morale ?
A l’origine du bon et du mal
Selon Nietzsche, la morale et plus généralement la notion de bien et de mal sont des concepts dont le sens initial s’est perdu en route. Ce qui est bon n’est pas “ce qui est utile” contrairement à ce qu’une analyse de surface peut laisser penser.
Le philosophe se lance alors dans un travail qui mêle l’histoire et la psychologie afin d’aboutir à une généalogie. Ce que nous appelons “bon” aujourd’hui, n’est pas, selon lui, le produit de l’utilité ou du progrès. Ce n’est pas une construction patiemment élaborée pour rendre la vie plus douce, plus juste. Non. C’est un masque, un retournement.
Le bon, le mal, la morale trouvent leurs origines dans l’aristocratie antique.
Que peuvent bien signifier, au point de vue étymologique, les désignations du « bon » forgées dans les différentes langues ? C'est là que j'ai découvert qu'elles renvoient toutes autant qu'elles sont à la même mutation conceptuelle — que partout, « noble », « aristocratique » au sens du statut social est le concept fondamental à partir duquel se développe nécessairement le « bon » au sens de « qui a l'âme noble », « aristocratique » au sens de « qui a une âme de nature élevée », « qui a une âme privilégiée » : le développement qui s'effectue toujours parallèlement à cet autre qui finit par faire évoluer le « commun », le « plébéien », « bas » vers le concept de “mauvais”.1
Le bon n’est pas une affaire d’utilité mais une affaire de castes et de force. Est bon ce qui est noble, fort comme le guerrier. Est mauvais ce qui est banal, faible comme l’esclave. Autrement dit, la morale n’a pas toujours été cette religion de la compassion et de l’égalité.
Elle fut d’abord un cri de puissance, lancé par ceux qui n’avaient pas à se justifier d’exister, comme un écho lointain du discours sur la division du monde entre les “winners” et les “losers” du président américain.
La morale des forts contre la morale des faibles
Alors oui, Trump mis à part, notre vision du bien et du mal aujourd’hui est bien différente. Nietzsche l'explique en faisant appel à la psychologie : la création d’un camp du ressentiment formé par les faibles.
La grande coupable de ce renversement sémantique (qu’il regrette) est la religion et son armée : les prêtres du christianisme, oui, ce sont eux les coupables. (Notons qu’il fait avancer son analyse en utilisant comme moteur l’antisémitisme, hélas si commun au XIXe siècle. Il accuse donc les Juifs, qui “commencent le soulèvement d’esclaves en morale”2).
Le soulèvement des esclaves dans la morale commence avec le fait que le ressentiment devient lui-même créateur et enfante des valeurs : le ressentiment de ces êtres auxquels la véritable réaction, celle de l’action, est interdite et qui ne se dédommagent qu’au moyen d’une vengeance imaginaire.3
En réaction à la morale aristocratique, à la morale désinhibée et vitale du plus fort, le christianisme selon Nietzsche a bâti sa revanche morbide4 avec une morale de l’ombre, du retrait, de l’âme qui saigne en silence, où le mal est grimé en bien, où la faiblesse s’habille en vertu, et où la force devient soupçonnée de tous les péchés.
C’est cette morale que transgresse Trump dans ses actes et ses discours. Il combat les élites politiques américaines qui affichent ces valeurs issues du christianisme, en lui opposant une morale de la force brute. En somme, en termes nietzschéens, il combat le ressentiment par le ressentiment.
La nouvelle morale chrétienne
Dans le chapitre 14 de la première dissertation, Nietzsche engage un dialogue avec un lecteur imaginaire pour expliquer cela :
« La faiblesse doit être, à coups de mensonge, renversée en mérite, cela ne fait aucun doute c'est exactement ce que vous disiez. »
— Et puis
— « et l'impuissance qui n'exerce pas de représailles en “bonté" ; la bassesse craintive en “humilité" ; la soumission à ceux que l'on hait en “obéissance" (à savoir à l'égard de quelqu'un dont ils disent qu'il ordonne cette soumission, — ils l'appellent Dieu). Le caractère inoffensif du faible, la lâcheté même, dont il est abondamment pourvu, le fait qu'on le laisse à la porte, qu'il soit inéluctablement contraint d'attendre se voient ici décerner des dénominations élogieuses, telle la patience", on se plaît aussi à appeler cela la vertu ; son incapacité à se venger s’appelle volonté de ne pas se venger, peut-être même pardon (“car ils ne savent pas ce qu’ils font — nous seuls savons ce qu’ils font !”). On parle aussi de l’amour de ses ennemis — tout en transpirant.”5
Selon l’auteur allemand, cette nouvelle morale, celle des esclaves, est une absurdité contraire à la nature, contraire à la vie. La morale doit donc revenir à ses origines naturelles, où l’on ne peut “faire grief aux grands oiseaux de proie de s’emparer de petits agneaux.”6
Un peu d’auto-promo ici pour vous rappeler que vous pouvez désormais soutenir la newsletter en remplissant sa tirelire 😉.
Là encore, en s’en tenant à cette vision, il est donc tout à fait moral pour Trump de vouloir s’arroger le Groenland ou les terres rares d’Ukraine.
Conclusion
En vérité, on imagine mal le président américain être un grand lecteur de Nietzsche, mais constatons leur proximité sur certains aspects : la force comme boussole, la division du monde en castes, la volonté d'apparaître comme un surhomme ou la transgression permanente comme socle d'une morale prédatrice.
Mais le limites de l’exercice sont vite atteintes. Les plus évidentes ici sont le nihilisme (décrit par Nietzsche comme « non seulement la croyance que tout mérite de périr, mais qu’il faut détruire »), le cynisme et le rapport contrarié avec la vérité (la liste des bobards est trop longue) que Nietzsche abhorrait, bien loin de l’idée de la noblesse fondatrice vantée par le philosophe allemand.
Au fond, n’est pas l’héritier de Nietzsche qui veut.
Désormais, le spectacle de l'homme fatigue — qu'est-ce que le nihilisme aujourd'hui, sinon cela ?.. Nous sommes fatigués de l'homme.7
✨ Et nous accueillons Corine, Sylviane, Karen ainsi que tous les nouveaux abonnés depuis la dernière édition. Soyez les bienvenus !
Quelques ressources en plus de la lecture du livre :
Monsieur Phi, Nietzsche, la morale des winners
Les bons profs, Généalogie de la morale
Si vous identifiez des erreurs, merci de m'informer par e-mail en répondant à ce message.
Alexandre
Généalogie de la Morale,§4, édition Le livre de poche, p70
Généalogie de la Morale, §7, édition Le livre de poche, p79
Généalogie de la Morale, §10, édition Le livre de poche, p82
“L'humanité elle-même souffre encore des répercussions de ces naïvetés thérapeutiques des prêtres ! Songeons par exemple à certaines formes de régime (le fait de s'abstenir de viande), au jeûne, à la continence sexuelle, à la fuite « au désert »” Généalogie de la Morale, §6, édition Le livre de poche, p76
Généalogie de la Morale, §14 édition Le livre de poche, p101
Généalogie de la Morale, §13, édition Le livre de poche, p96
Généalogie de la Morale, §13, édition Le livre de poche, p96