Tout le contenu de Morale de l’Histoire est en libre d’accès afin d’être lu par un maximum de personnes. Si vous souhaitez marquer votre soutien à Morale de l’Histoire, c’est possible en souscrivant à un abonnement mensuel (le prix de 3 ☕️ par mois) ou annuel (2 ☕️ par mois). Un grand merci à ceux qui le feront !
Bonjour à tous,
Morale de l’Histoire, c’est désormais le dimanche trois fois par mois.
J'ai eu la joie, il y a un an, de recevoir dans l'émission Jean-Édouard Grésy, venu nous parler des négociations qui ont fait l'Histoire de France.
Nous allons nous pencher une nouvelle fois sur le thème de la négociation dans l'histoire en nous intéressant aujourd'hui à l'un des épisodes fondateurs de la diplomatie occidentale : la Guerre de Trente Ans et les Traités de Westphalie.
Bonne lecture,
Alexandre
Quand un monde s’effondre et qu’un nouveau est empêché de naître, la guerre n’a jamais besoin d’une invitation. Celle de Trente Ans (1618-1648) est l'un de ces épisodes. C’est un carnage qui, entre les batailles, les massacres de masse et les épidémies, coûtera la vie à 20 % de la population européenne.
Après tant de destructions et de sang versé, comment les Européens ont-ils tout de même réussi à construire la paix ? Qu’est-ce que cela a changé à la géopolitique de notre continent ?
Tout commence sur les terres du Saint-Empire romain germanique.
D’un conflit local à une guerre européenne

Le Saint-Empire germanique est un puzzle composé de centaines de principautés, duchés, villes libres et royaumes, tous sous l’autorité de l’empereur Ferdinand II, membre de la maison des Habsbourg, cette famille catholique qui, depuis Charles Quint, règne à la fois sur le sud, le nord et l’est de l’Europe.
Son empire est un géant aux pieds d’argile qui recouvre le territoire de l’Allemagne actuelle, de l’Autriche, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la République Tchèque et enfin quelques terres de France, d’Italie ou de Pologne. Sacré morceau.
Fervent catholique, il juge bon de revenir sur les libertés religieuses accordées aux protestants par le traité d’Augsbourg de 1555. Il n’en fallait pas plus pour raviver les tensions entre les différentes communautés, déjà attisées par le durcissement progressif des lois envers la Réforme.
Le 23 mai 1618 à Prague, deux gouverneurs catholiques, représentants de l’empereur, sont défenestrés par des nobles protestants. Le tas de fumier qui amortit leur chute leur sauve la vie mais pas la paix : la guerre vient de trouver son prétexte. Cette étincelle, par le jeu des alliances principalement autour de la rivalité entre les Habsbourg et leurs opposants, déclenche le feu sur le territoire du Saint-Empire.
Les forces en présence sont, d’un côté, la Ligue catholique, menée par l’empereur Ferdinand II et soutenue par l’Espagne des Habsbourg, le Saint-Empire et les royaumes catholiques d’Europe. Leur objectif est de rétablir la suprématie du catholicisme et de renforcer l’autorité impériale.
De l’autre, nous avons l’Union protestante, composée de plusieurs princes du Saint-Empire et appuyée par la Suède, l’Angleterre et les Provinces-Unies. Ils s’opposent à cette domination catholique.
Et puis il y a la France, prise en étau entre l’Espagne et le Saint-Empire.
La France entre en guerre en 1635 sous l'impulsion de Richelieu. Dans le théâtre des nations, il y a un rôle plus important que celui du croyant : celui du stratège. C'est pourquoi la France catholique de Richelieu fait alliance avec la Suède protestante de Gustave II Adolphe. La guerre bascule. En 1643, à Rocroi, les Espagnols sont défaits. La bataille de Jankau en 1645 affaiblit une nouvelle fois le Saint-Empire.
C’est le moment de négocier la paix.
✨ Un peu d’auto-promo avant la suite du récit.
Morale de l’Histoire, c’est une newsletter hebdomadaire dédiée à l’Histoire et à la philosophie.
De la féodalité religieuse au compromis politique
Les négociations ont lieu à deux endroits : Münster pour les catholiques et Osnabrück pour les protestants. Plus de 400 diplomates du côté français, environ 150 pour chaque autre grande puissance – Suède, Espagne, Saint-Empire. C’est le premier grand congrès diplomatique européen.
Devant la difficulté des échanges, les plénipotentiaires prennent acte de l’impossibilité pour les catholiques et les protestants de s’accorder sur le dogme. La discussion théologique est donc évacuée afin de laisser place à la discussion géopolitique. On range la Bible, on sort les cartes. C’est un tournant. La norme juridique devient le moyen de régler les conflits.
"Il y a la volonté de trouver une solution au conflit religieux sur un plan juridique pour pacifier." Claire Gantet, dans l’émission Storiavoce “Les traités de Westphalie : un tournant dans les relations internationales”1
Les traités de Westphalie regroupent plusieurs accords signés entre différentes puissances européennes. Celui de Münster, le 30 janvier 1648, où l’Espagne reconnaît l’indépendance des Provinces-Unies, celui d’Osnabrück, le 24 octobre, qui met fin aux hostilités entre la Suède et le Saint-Empire, et enfin le traité de Münster, le même jour, qui scelle la paix entre la France et le Saint-Empire.
Le grand perdant ? Le Saint-Empire.
Il ressort morcelé en 350 États autonomes et privé de certains territoires comme la Suisse ou les Provinces-Unies. La France et la Suède en profitent pour en gagner quelques-uns (l’Alsace par exemple) et asseoir leur influence.
Jacques Bainville résume dans son Histoire de France la situation :
Au traité de Westphalie, la politique qui avait toujours été celle de la monarchie française, celle des « libertés germaniques », reçut sa consécration. Notre victoire fut celle du particularisme allemand. La défaite de l'empereur fut celle de l'unité allemande.2
Les traités de Westphalie mettent fin à l'un des conflits les plus meurtriers du continent européen. Mais son impact va au-delà des cartes.
De l’universalité à l’équilibre
Au delà des aspects territoriaux, ils consacrent plusieurs principes fondamentaux qui vont régir les rapports entre états durant les siècles suivants.
Henry Kissinger dans son fameux livre Diplomatie partage sa vision de cette époque charnière entre deux mondes. Avant, on se battait pour la foi. Après, on se battra pour l’équilibre des forces. La différence fait toute l’histoire.
Ce que les historiens appellent aujourd'hui l'équilibre européen naquit au XVI ème siècle de l'effondrement définitif de l'idéal médiéval d'universalité : un ordre du monde dans lequel se mêlaient les traditions de l'Empire romain et celles de l'Église catholique. On imaginait le monde à l'image des cieux. Un seul Dieu régnait au ciel, un seul empereur devait donc gouverner le monde séculier, et un seul pape l'Église universelle.3
Hors, le développement de la Réforme brise cette universalité. Il faut donc trouver un autre levier que la religion ou la morale pour agir au nom de l’état. Cela sera la Raison d’état.
Kissinger voit en Richelieu son incarnation.
Richelieu fut le père de l'État moderne. Il vulgarisa la notion de raison d'État l'appliqua avec persévérance au profit de son pays. Sous son égide, la raison d'État se substitua à la vieille notion médiévale de '“valeurs morales universelles » comme principe opérant de la politique de la France.4
C'est pourquoi, afin de déstabiliser les Habsbourg et leur menaçant royaume, il n'hésite pas, lui le Cardinal, à soutenir les protestants dans leur lutte.
« L'homme est immortel, son salut est dans l'autre vie. L’État n'a pas d'immortalité, son salut est maintenant ou jamais .» Richelieu
Mais cela n’est pas suffisant. La raison d’état, permettant de justifier n’importe quelle action allant dans le sens de l’intérêt national, a une énorme limite ; celle de ne pas en avoir.
Car on peut tout justifier avec la Raison d’état. Le concept est assez large et confortable pour accueillir les ambitions d’un dirigeant imprudent. C’est l’écueil du règne de Louis XIV, roi de la guerre trop oublieux de la paix, qui finit par briser l’équilibre qu’il voulait dominer. Car un État qui ne connaît que la conquête finit toujours par rencontrer une frontière infranchissable : celle du reste du monde.
Ce besoin d'équilibre entre les puissances se fait ressentir plus clairement en Angleterre, qui, de par sa position géographique, voit comme une menace l'émergence d'une puissance dominatrice en Europe.
La politique de l’Angleterre consistait essentiellement à jeter tout son poids, le cas échéant dans le camp le plus faible et le plus menacé afin de rétablir l’équilibre. […]
L'Angleterre était le seul pays européen que sa raison d'État n'obligeait pas à rechercher une expansion en Europe. Estimant que son intérêt national consistait à préserver l'équilibre européen, elle était aussi le seul pays dont les visées personnelles sur le continent se limitaient à empêcher celui-ci de tomber sous la domination d'une puissance unique.
Forte de cet objectif, elle se mettait à la disposition de n'importe quelle coalition de nations opposées à une entreprise de cette nature.5
Une Europe équilibrée, c’est une Angleterre en sécurité.
Conclusion
Les Traités de Westphalie nous invitent à penser les relations entre États à hauteur d'hommes, en dehors des considérations morales et religieuses, trop fragiles et trop rigides pour ouvrir un chemin vers la paix.
Au fond, la paix westphalienne substitue la religion par le droit, la morale par la raison d'État, et la domination par la recherche d'équilibre. Des leçons pour des générations de diplomates.
✨ Si le sujet vous intéresse, je vous conseille quelques podcasts pour creuser :
Si vous identifiez des erreurs, merci de m'informer par e-mail en répondant à ce message.
Alexandre
Claire Gantet est l’auteure de La Guerre de Trente Ans, éditions Tallendier
Histoire de France, éditions Perrin, p205
Diplomatie, Henry Kissinger, éditions Fayard, p47
Diplomatie, Henry Kissinger, éditions Fayard, p49
Diplomatie, Henry Kissinger, éditions Fayard, p60




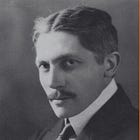
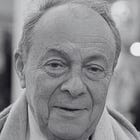
Tu l'apprécies beaucoup ce livre de Kissinger 👀
Il a l’avantage d’offrir une vision claire de la géopolitique ;