Tout le contenu de Morale de l’Histoire est en libre d’accès afin d’être lu par un maximum de personnes. Si vous souhaitez marquer votre soutien à Morale de l’Histoire, c’est possible en souscrivant à un abonnement mensuel (le prix de 3 cafés par mois) ou annuel (2 cafés par mois). Un grand merci à ceux qui le feront !
Bonjour à tous,
Petit bilan de l’année pour Morale de l’Histoire :
40 numéros accessibles à tous,
287 000 lettres tapées,
236 minutes de lecture soit 3 h 56,
700 abonné(e)s supplémentaires, nous sommes désormais (presque) 900,
7 000 visiteurs,
et 35 000 visites.
J'ai travaillé sans relâche et je vous remercie tous pour votre soutien sous forme de likes, de partages, de commentaires et de mécénat via l’abonnement payant.
Nous nous retrouverons en 2025 pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, terminons l'année en parlant de démocratie comme promis.
Bonne lecture,
Alexandre
✨ Et nous accueillons Laurent, Nicolas, Aline, Charles et une trentaine de nouveaux abonnés depuis la dernière édition. Soyez les bienvenus !
Platon, témoin d’une Athènes vacillante, où la grandeur s’éteint sous le poids de ses contradictions, est à l’origine d’une réflexion fondamentale sur la démocratie.
Athènes, forge de l’idée démocratique, fut aussi le théâtre cruel de ses désillusions. La guerre du Péloponnèse éclate alors que le jeune Platon n’a que 4 ans, fracturant une cité qui se croit invincible. La peste et la victoire spartiate balaient la démocratie athénienne comme un fétu de paille. L’oligarchie s’impose. Mais les Athéniens, têtus comme seuls les rêveurs savent l’être, rétablissent une démocratie aussi fragile que chancelante. Paradoxalement, c’est elle qui condamne Socrate à boire la ciguë. Le maître s’éteint, et Platon commence à rêver d’une cité idéale.
Platon : La Démocratie comme un défi
Dans La République, Platon prend le contrepied de Protagoras et de l’idée selon laquelle « l’homme est la mesure de toute chose ». La démocratie, construite autour d’un absolu égalitaire et libertaire, dissociant le savoir du pouvoir, ouvre la voie, selon lui, à la tyrannie.
À la racine de ce mal se trouve l’individualisme, qui dissout la société et fait vaciller l’autorité. C’est dans ce chaos que surgit le démagogue, s’emparant des émotions du peuple et cueillant le pouvoir comme une grenade mûre.
Alors, Platon rêve.
Non pas d’un retour en arrière, mais d’une aristocratie éclairée, où les philosophes seraient rois, où la connaissance guiderait le pouvoir, et où la justice primerait sur la liberté et l’égalité, pourtant au cœur du principe démocratique.
La critique de la démocratie par Platon est fondatrice, car elle constitue, paradoxalement, la première pierre de l’édifice des régimes démocratiques modernes. Comme l’écrit Marc-Antoine Gavray dans cette analyse éclairante, c’est “le défi” que Platon nous oblige à relever.
Jean-Jacques Rousseau : La Démocratie comme instrument de la volonté générale
Rousseau réfléchit la démocratie dans Du contrat social (1762). Son idéal est vertigineux, lumineux et exigeant. Le contrat social consiste à troquer sa liberté naturelle pour une liberté civile qui a comme avantage de me protéger, dans un régime où le rôle de souverain est joué par le peuple et non par un roi ou un despote. En somme, l’État et les lois, c’est nous.
L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté
Livre I, Chapitre VIII
Le philosophe genevois imagine des citoyens qui transcendent leurs intérêts personnels et pensent comme un seul être, guidés par la volonté générale. Chacun oriente ainsi ses décisions politiques en fonction de l'intérêt de la cité.
C’est là, dans cette alchimie mystérieuse entre l’individu et le collectif, que repose l’architecture démocratique selon Rousseau. Un peuple souverain, maître de son destin, délibérant et votant sans intermédiaire.
La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu.
Livre III, chapitre XV
Selon Rousseau, le peuple souverain conçoit les lois dans l'intérêt général, tandis que le gouvernement, simple exécutant, les applique et gère les intérêts particuliers.
À la critique du développement de l’individualisme en Démocratie exprimée par Platon, Rousseau répond que l’individu a des intérêts communs avec l’intérêt général. C’est là que se trouve le moteur d’une démocratie vertueuse pour peu que les intérêts particuliers soient traités en dehors du peuple.
Je vous conseille cette vidéo qui explique plus en détail la pensée de Rousseau :
Alexis de Tocqueville : la Démocratie comme exercice de citoyenneté
Cet aristocrate normand est mandaté par le ministère de l’Intérieur en 1831. Il débarque en Amérique avec une mission officielle : étudier le système pénitentiaire. Mais Tocqueville n’est pas homme à se contenter des consignes.
Il sillonne les États-Unis, son laboratoire d’expérimentation sociale. Il scrute dans les paysages de ce jeune pays, à peine sorti des langes de la Déclaration d’indépendance de 1776, la pratique démocratique qu’il s’est donné comme horizon.
Il y a quelque chose chez Tocqueville d’un grand reporter philosophe.
Roger-Pol Droit, Une brève histoire de la philosophie, p. 271
Lorsqu’il regagne la France, il n’a pas seulement des observations dans ses bagages : il porte en lui la matière d’une œuvre majeure de la philosophie politique. De la démocratie en Amérique paraîtra en deux volets, le premier en 1835, le second en 1840.
Mais qu’a-t-il donc vu, là-bas ?
Ce qui saisit d’emblée Tocqueville, c’est cette « égalité des conditions », qu’il évoque dès la première page de l’introduction :
Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions.
De la démocratie en Amérique, Tome I, Introduction
C’est là la racine de cette démocratie américaine, une idée qui s’épanouit jusque dans les premières lignes de la Déclaration d’indépendance :
Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.
Attention toutefois : cette égalité n’est pas économique. Mais elle s’oppose frontalement aux sociétés de castes encore florissantes en Europe, où la naissance décide de tout. Ici, chacun peut passer en théorie du statut de serviteur à maître — et inversement (à l’exception des esclaves à l’époque).
Pour Tocqueville, la démocratie n’est pas qu’une curiosité américaine : elle est une force sociale destinée à conquérir le monde. Il le dit sans ambages :
Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors lutter contre Dieu même, et il ne resterait aux nations qu’à s’accommoder à l’état social que leur impose la Providence.
De la démocratie en Amérique, Tome I, Introduction
Mais il n’est pas dupe. Des ombres accompagnent cette lumière. Il perçoit comme Platon les germes d’un individualisme destructeur qu’il décrit ainsi :
L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables, et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même.
De la démocratie en Amérique, Tome II, Partie II, Chapitre II
C’est une pente naturelle, impossible à remonter complètement. Mais qui met en danger la Démocratie car la quête de confort matériel prime alors sur la quête de liberté, pourtant essentielle. L’individualisme endort la démocratie.
À l’horizon se profile alors l’abandon de l’exigence démocratique par des citoyens choyés par un despotisme insidieux, sans violence apparente :
Il semble que si le despotisme venait à s’établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d’autres caractères : il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter.
[…]
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, a travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger.
De la démocratie en Amérique, Tome II, Partie IV, Chapitre VI
Face à cela, Tocqueville prône une sorte de démocratie participative (je reprends l’expression utilisée par Agnès Antoine, auteure de L’impensé de la Démocratie) où le citoyen peut “exercer” la démocratie au niveau local et constater la convergence entre ses intérêts privés et l’intérêt général.
On tire difficilement un homme de lui-même pour l'intéresser à la destinée de tout l'Etat, parce qu'il comprend mal l'influence que la destinée de l'Etat peut exercer sur son sort. Mais faut-il faire passer un chemin au bout de son domaine, il verra d'un premier coup d'œil qu'il se rencontre un rapport entre ces petites affaires publiques et ses plus grandes affaires privées, et il découvrira, sans qu'on le lui montre, le lien étroit qui unit ici l'intérêt particulier à l'intérêt général.
C'est donc en chargeant les citoyens de l'administration des petites affaires, bien plus qu'en leur livrant le gouvernement des grandes, qu'on les intéresse au bien public et qu'on leur fait voir le besoin qu'ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire.
De la démocratie en Amérique, Tome II, Livre I, Chapitre IV
Que des penseurs comme Raymond Aron aient remis son œuvre au goût du jour n’a rien d’étonnant. Tocqueville place la liberté au centre de la démocratie afin d’éviter qu’elle ne s’use faute d’être utilisée. Aujourd’hui encore, ses idées irriguent la pensée libérale.
Je vous conseille ce podcast qui explique plus en détail la pensée de Tocqueville.
Raymond Aron : la Démocratie comme concurrence pour l’exercice du pouvoir
Dans son Introduction à la philosophie politique, Raymond Aron démasque les illusions. Réduire la démocratie à la “souveraineté du peuple” ? Une chimère, un piège. Aron refuse les slogans creux et choisit les faits : caractériser par la mécanique et non par l’idée.
Comme dans L’opium des intellectuels en 1955, où il opposait l’idéal communiste à la réalité soviétique, il examine la démocratie à l’aune de ses rouages, non de ses promesses.
“Expliquer un régime politique ou l’analyser, c’est toujours le dépoétiser.”
Pour lui, la démocratie, loin des rêveries, est “l’organisation de la concurrence pacifique en vue de l’exercice du pouvoir”.
Cette concurrence, fragile par nature, n’a de sens que si elle est équitable. Lorsque l’opposition est étouffée, comme en Russie ou au Venezuela, la démocratie meurt. Aron ne se fait pas d’illusions : toute démocratie est, au fond, une oligarchie, mais elle doit respecter trois piliers — souveraineté du peuple, liberté, égalité — concrétisés par des institutions solides.
Comparant les traditions anglaises, libérales, et françaises, étatiques, il montre que la démocratie n’a rien d’homogène. “Ces deux tendances de la démocratie ont eu une représentation historique assez claire…” Aron embrasse le paradoxe : une démocratie lente et imparfaite, mais protectrice face aux dérives autoritaires.
Lenteur, compromis, tensions : Aron ne cache pas les défauts de la démocratie. Mais il en célèbre la vertu essentielle :
“Les démocraties ont surtout la vertu de protéger des folies des autres régimes.”
Elle agace, avec ses débats interminables, mais intègre ses opposants, prévenant les explosions tyranniques. Réalisme lucide, presque machiavélique : la démocratie, c’est la lutte permanente pour équilibrer ambition et institution.
Conclusion
La démocratie est un équilibre délicat entre la liberté et l'égalité, l'intérêt personnel et le bien collectif, le peuple et le gouvernement. Elle n’a pas de forme figée et reste une conquête de tous les jours.
Alors au fond, relever le défi de Platon, c’est la plébisciter et la faire vivre… Malgré l’adversité.
Si vous identifiez des erreurs, merci de m'informer par e-mail en répondant à ce message.
Alexandre

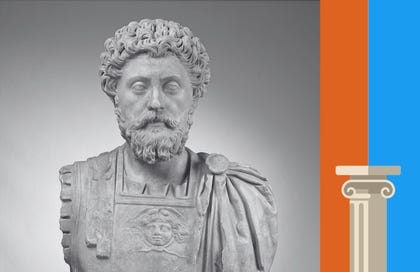


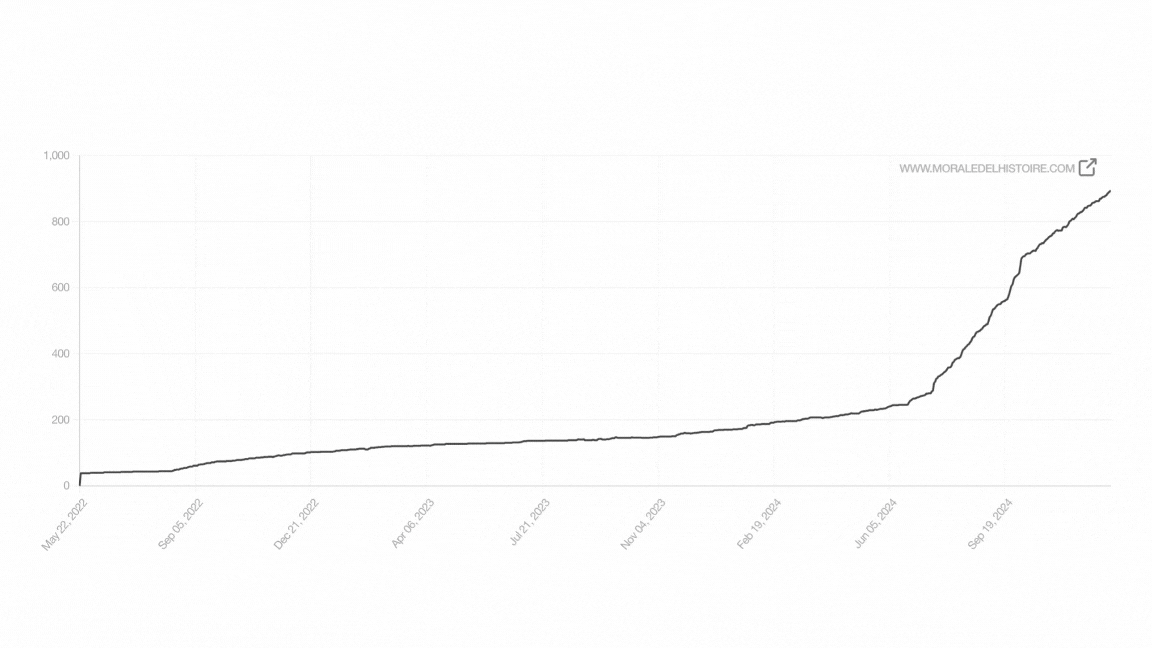
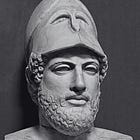


On voit bien à travers Platon, Rousseau et Tocqueville que la démocratie est toujours un équilibre instable entre liberté et responsabilité collective. La critique de l’individualisme excessif est particulièrement d’actualité
Un excellent article ! Joyeuse année civile et mes vœux de franc succès à vous.